Gilles Favarel-Garrigues et Laurent Gayer, deux chercheurs du CNRS, ont publié une enquête passionnante sur les « justiciers autoproclamés », ces citoyens devenant parfois de véritables milices armées, qui pullulent dans le monde entier, de l’Amérique latine à la Russie, en passant par le Nigeria. La France, elle, se distingue par le fait les autorités ont toujours concédé dans son histoire récente des exemptions à certains acteurs privés résolus à faire la loi hors du cadre légal, afin de maintenir l’ordre économique et politique. Plongée au cœur du monde de ces mercenaires d’un nouveau genre.
LR&LP : Qu’est-ce qui vous a donné envie de mener cette enquête sur les auto-justiciers ?
Au cours des années 2000, nous avons chacun observé sur nos terrains respectifs – la Russie d’une part, l’Inde et le Pakistan d’autre part – un engouement croissant pour le vigilantisme, c’est-à-dire pour le recours à des méthodes extra-légales, de la part de citoyens ordinaires, en vue de maintenir l’ordre ou de rendre la justice par eux-mêmes, en réponse à une défaillance présumée des appareils policiers et judiciaires.
En Inde comme en Russie, ces groupes ont pris de l’ampleur au cours de la décennie suivante, bénéficiant souvent de protections au sein de la classe politique ou de l’administration. C’est le cas des militants nationalistes hindous qui, suite à l’accession au pouvoir de Narendra Modi en 2014, ont bénéficié d’une impunité croissante pour harceler les musulmans et les Dalits au nom de la protection des vaches et de l’application de nouvelles législations interdisant leur abattage et la commercialisation de la viande bovine.
L’influence de ces militants se fait aussi sentir dans le domaine artistique, où leurs activités de police culturelle visent à édicter et faire respecter de nouveaux interdits. En Russie, également, cette période a été marquée par une efflorescence de groupes de justiciers résolus à faire la police par eux-mêmes, hors du cadre légal.
C’est ce phénomène que nous avons observé, d’abord dans les sociétés que nous étudions, puis à une échelle mondiale, en engageant un vaste travail comparatif.
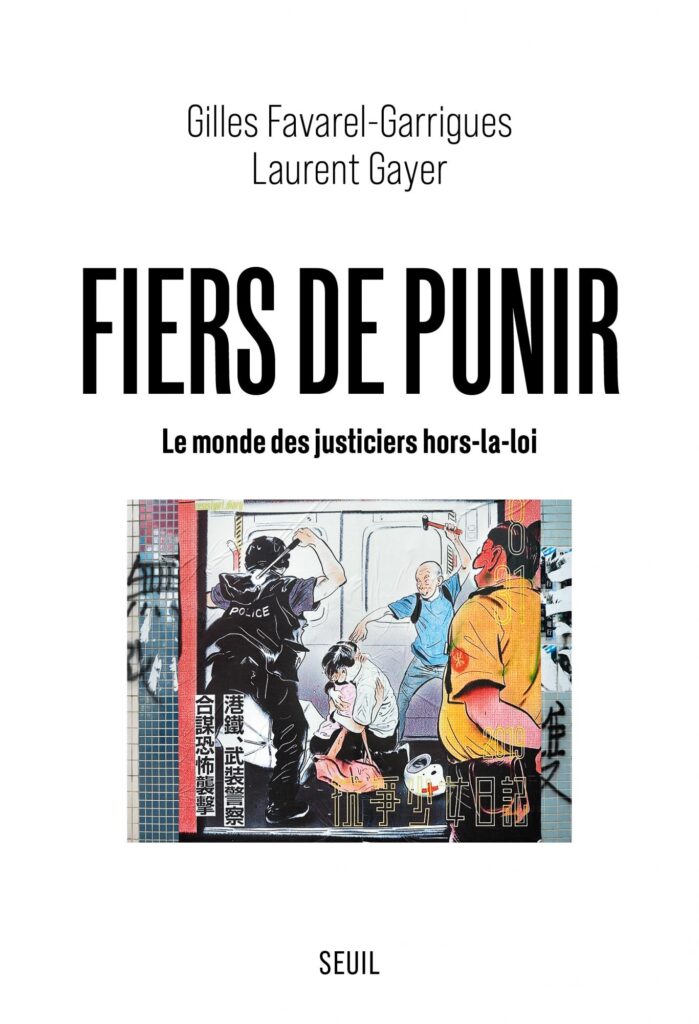
Des groupes d’autodéfense du Far West aux chasseurs de pédophiles en Russie contemporaine, les justiciers hors-la-loi sont typiquement des hommes blancs, réactionnaires et xénophobes. Toutefois, mouvements révolutionnaires et défenseurs des dominés ne s’interdisent pas de manier, à leur tour, le fouet et le feu. L’auto-justice compte en outre de fervents zélateurs dans les services répressifs. Et quand policiers et paramilitaires s’affranchissent du cadre légal pour nettoyer la société, ils précipitent l’avènement de l’État justicier.
LR&LP : La question de l’acceptation sociale est prédominante pour donner légitimité aux justiciers auto-proclamés…
Les groupes de justiciers retenant notre attention sont tous en quête de légitimité. Ils se mobilisent au nom d’une cause et d’un groupe de référence : le « peuple », les « honnêtes citoyens », les gens du quartier, la communauté villageoise… Et ils s’adressent à un public, pris à partie, dont ils attendent la validation de leurs actions controversées.
Il est essentiel pour eux de se distinguer d’assassins vindicatifs, au service de leurs intérêts matériels ou leurs névroses personnelles. Et tout en critiquant leur performance, ces justiciers recherchent l’approbation, au moins tacite, des autorités officielles. Sans un minimum de protection étatique, ces groupes s’exposent en effet à des sanctions judiciaires immédiates.
S’ils sont souvent convaincus de leur bon droit, ils se montrent généralement prudents. Avant de passer à l’action, ils mesurent leurs chances d’impunité. C’est d’ailleurs pour cela qu’ils choisissent souvent leurs victimes dans les catégories les plus vulnérables de la population, celles que personne ou presque n’ira défendre : les marginaux, les étrangers, les fous, les pédophiles ou les voleurs d’enfants.
Autant d’incorrigibles suscitant une aversion généralisée et un faible intérêt des services de police en cas de disparition.
LR&LP : A l’inverse, les simulacres de procès relèvent d’une volonté de « justice légitime », comment analysez-vous ces deux opposés ?
La justice sommaire mise en œuvre par ces groupes repose sur un double paradoxe : elle viole la loi au nom du maintien de l’ordre et elle critique la défaillance des services policiers et judiciaires tout en singeant leurs procédures.
Les justiciers hors-la-loi ne sont pas des anti-système : ils ont intériorisé la mentalité juridique de l’Etat de droit et tout en le foulant aux pieds, reproduisent ses rituels, ses codes… Leurs simulacres de procès témoignent là encore de leur quête de légitimité, de leur volonté de se distinguer de vengeurs à la violence arbitraire.
En même temps, ils s’inscrivent en rupture avec plusieurs aspects fondamentaux de l’Etat de droit et de la justice pénale moderne : ils rejettent par exemple la présomption d’innocence, les droits de la défense ou encore la possibilité de faire appel, et prônent une justice intransigeante, sommaire et spectaculaire, renouant avec les cérémonies punitives d’antan.
Par contraste avec les institutions pénales contemporaines qui, comme l’a montré Michel Foucault, ont soustrait l’administration du châtiment au regard du public, ils sont fiers de punir et n’ont de cesse de le rappeler à travers leurs rituels publics d’humiliation voire d’exécution.
LR&LP : Le phénomène du Whatsapp lynching en Inde a tout de l’épisode de Black Mirror épisode 2 de la saison 2 « La chasse ». Dans le pays, des présumés coupables de rapts d’enfants et prélèvement d’organes ont été traqués puis lynchés par la foule qui diffuse à la fois les rumeurs et la punition via ce réseau social.
Les réseaux sociaux n’ont pas inventé la mutualisation de la surveillance, la dénonciation publique ou les spectacles punitifs. Ils leur ouvrent pourtant de nouvelles perspectives. Le développement de ces nouvelles technologies d’information et de communication accroît en effet le risque de passage à l’auto-justice en soulevant des émotions intenses, en diffusant des rumeurs anxiogènes et en accroissant la tentation de jouer au détective, seul ou en groupe, avec tous les risques de bavure que cela comporte.
C’est ce que l’on a pu constater au moment du Marathon de Boston en 2013, lorsqu’un étudiant américain d’origine indienne a été identifié par erreur par les internautes comme le responsable des attentats, donnant lieu à une virulente campagne de harcèlement contre sa famille.
LR&LP : Fait notable, les justiciers autoproclamés sont aussi bien du côté des dominants que des exploités…
En tant que boîte à outils, proposant des méthodes simples et bon marché pour réparer des torts, l’auto-justice est à la portée de toutes les bourses et de toutes les causes. Elle peut tout à fait être appropriée par des groupes dominés ou des mouvements progressistes.
Cela a pu être le cas dans les années 1970, de la part de mouvements d’extrême-gauche ciblant grands patrons ou responsables politiques au nom de la « justice populaire ».
C’est aussi le cas de la part de groupes de femmes comme le « gang des saris roses » en Inde, qui s’est approprié le lathi – la canne en bambou associée aux policiers brutaux et aux hommes de main des dominants – pour mettre au pas maris violents ou fonctionnaires corrompus.
Avec le développement des réseaux sociaux, la pratique du naming and shaming devient aussi une arme de choix pour les militant·es féministes et les victimes de violence sexuelle, résolu·es à châtier leurs agresseurs en les exposant à une visibilité non sollicitée.
L’auto-justice, et le vigilantisme en particulier, c’est-à-dire sa forme la plus organisée et pérenne, ne se réduisent pourtant pas à un répertoire de pratiques contestataires. C’est aussi une idéologie, reposant sur une critique virulente du fonctionnement de la justice officielle, perçue comme trop lente, trop laxiste et trop protectrice des droits des criminels aux dépens de ceux des victimes.
A cette justice officielle, défaillante et compromise avec les forces du désordre, les justiciers opposent le modèle d’une contre-justice aussi bon marché qu’intransigeante, supposée donner corps à la souveraineté populaire.
Si ce discours a pu, à l’occasion, être récupéré par des groupes progressistes, il est plutôt associé à des groupes réactionnaires en froid avec l’État de droit, protégeant leurs acquis et réclamant une sévérité accrue à l’égard des délinquants voire des simples déviants heurtant leur conception de l’ordre et de la morale.
Historiquement, les justiciers hors-la-loi ont plutôt eu tendance à être au service des dominants. Aux Etats-Unis, par exemple, l’archétype du vigilante est un homme blanc, xénophobe, défendant coûte que coûte sa propriété et l’honneur des siens.
Dans bien d’autres contextes, l’auto-justice tend à se confondre avec la préservation de l’ordre établi, menacé par les luttes sociales, raciales, sexuelles ou environnementales.
Défense de la propriété et des frontières communautaires, au sens propre comme au sens figuré, figurent parmi les premières « causes » portées par les mouvements justiciers. Ces affinités électives de l’auto-justice avec le maintien de l’ordre établi font des redresseurs de torts des partenaires naturels des élites politiques et économiques les plus conservatrices, voire franchement réactionnaires.
Dans bien des cas, les justiciers servent aussi de nervis aux industriels, lorsqu’ils ne sous-traitent pas le « sale boulot » des partis politiques. Aux Etats-Unis au début du XXe siècle, par exemple, les vigilantes font la chasse aux « wobblies« , les syndicalistes révolutionnaires de l’IWW (Industrial Workers of the World).
Ces justiciers peuvent aussi mettre leurs réseaux de protection et leurs ressources coercitives au service d’activités d’enrichissement personnel. L’auto-justice peut alors se muer en une entreprise commerciale, licite ou non.
Les justiciers russes ont ainsi transformé leurs chaines Youtube, sur lesquelles ils diffusent leurs « raids » contre différentes sortes de contrevenants, en un véritable fonds de commerce. De manière encore plus controversées, certains justiciers peuvent s’engager dans des activités criminelles : chantage, extorsion, trafics en tous genres.

LR&LP : Récemment, en France, une grande manifestation a été organisée devant l’Assemblée nationale par les syndicats policiers qui trouvent que la justice les freine dans leur métier. Quelle est votre lecture de cette situation ?
Nous sommes inquiets de constater l’alignement des syndicats policiers sur une position de plus en plus critique vis-à-vis de l’Etat de droit, provoquant des effets de surenchère aux effets délétères.
Quelques jours avant cette manifestation, on a même entendu un syndicat policier, certes minoritaire, faire l’éloge de la guerre à la drogue menée par le Président Rodrigo Duterte aux Philippines, qui s’est soldée par des dizaines de milliers d’exécutions sommaires !
Cette surenchère s’observe également au sein de la classe politique, notamment à droite où chacun essaie de se distinguer par des propos radicalement critiques vis-à-vis du prétendu laxisme de la justice.
Si l’apologie de la manière forte se banalise dans la classe politique et le champ médiatique, pour autant la révolte contre l’Etat de droit qui couve en France n’a pas atteint le caractère dramatique de la terreur d’Etat observée au Brésil, en Inde ou aux Philippines.
Dans ces « Etats-justiciers », la violence extrajudiciaire est devenue un véritable mode de gouvernement, où certains justiciers s’apparentent à des punisseurs en uniforme pratiquant le nettoyage social avec la bénédiction des plus hautes autorités. Ces violences policières au caractère extrême démontrent que l’auto-justice ne relève pas toujours de débordements privés, mais peut aussi s’épanouir au sein même de l’Etat.
Lire aussi : « Quand le problème de la justice, c’est la police »
LR&LP : En France, il y avait des mercenaires antisyndicaux dans les années 1970, c’est une tradition d’avoir des citoyens vigilants supplétifs à l’état policier étatique ?
La France présente une situation paradoxale en matière d’auto-justice. Elle se prévaut d’une tradition juridique et administrative valorisant le pouvoir régalien, la codification du droit et le contrôle étroit des activités policières par l’État jacobin. Autant de singularités politiques qui contribuent à disqualifier les velléités justicières des citoyens.
Les contrevenants, qui s’aventureraient à faire la police ou rendre la justice par eux-mêmes, s’exposent ainsi à de lourdes sanctions pour « immixtion dans une fonction publique », comme l’a rappelé la récente condamnation de deux éleveuses de chevaux qui avaient arraisonné des automobilistes en Bretagne en 2020 pour contrôler leur identité.
Pour autant, le monopole public de la violence dite légitime est ici comme ailleurs une fiction. Tout au long de l’histoire récente, les autorités en place ont transigé avec ce principe en concédant des exemptions à certains acteurs privés résolus à faire la loi hors du cadre légal.
On pense bien sûr aux milices de l’Occupation mais, plus proche de nous, il faut aussi rappeler le rôle de ces gros bras qui, des usines en lutte aux manifestations de rue, viennent prêter main forte aux forces de l’ordre officielles et punir par eux-mêmes les contrevenants à une certaine idée de l’ordre.
Les mercenaires antisyndicaux des années 1970, émergeant à la croisée des syndicats patronaux, de l’extrême droite et des officines de barbouzes apparues dans le sillage du SAC, sont exemplaires de cette tendance. Soutenus par le grand patronat (chez Citroën et Peugeot, notamment), ils sévissent durant des années en bénéficiant de la bienveillance des autorités.
Et l’on aurait tort de croire que ces supplétifs du maintien de l’ordre économique et politique ont disparu. A Bure, par exemple, on a vu des vigiles recrutés par l’Andra, équipés de bric et de broc, faire la chasse aux militants écologistes sous le regard passif des gendarmes.
Lire aussi : Procès des opposants à l’enfouissement des déchets nucléaires : « Nous sommes toutes et tous des malfaiteurs ! »
LR&LP : Vous vous êtes rendus au Pays de la Loire, où les militants écologistes locaux subissent non seulement une répression policière et judiciaire hors-norme, mais aussi les menaces des riverains en désaccord avec leur combat. Qu’avez-vous pensé de la situation sur place ?
Les mobilisations écologistes constituent indéniablement un terrain de polarisation sociale et politique croissante en France aujourd’hui. La pratique des occupations, revivifiée par un certain nombre de collectifs au cours des dernières années, aiguise ces tensions.
On voit ainsi émerger des contre-mobilisations autour de la défense de la propriété, face à des populations jugées « marginales » et accusées de bafouer ce droit élémentaire tout en manquant à leurs obligations de citoyens responsables.
Dans le sillage des ZAD, de Sivens à Notre-Dame-des-Landes, se sont ainsi organisés des groupes d’agriculteurs ou de riverains, souvent structurés autour de syndicats agricoles défendant le modèle productiviste, à commencer par la FNSEA.
La mobilisation contre la création d’un Surf Park à Saint-Père-en-Retz et la contre-offensive à laquelle elle a donné lieu en 2019 confirme cette tendance. Là encore, les militants locaux de la FNSEA ont constitué le noyau dur de cette contre-mobilisation, mettant leur expérience militante, leurs ressources matérielles (tracteurs, tonnes à lisier) et leur réseau politique (relations avec la mairie, la préfecture, la gendarmerie) au service de leur cause.
Les militants écologistes présents sur place évoquent des contrôles d’identité sauvages, voire des fouilles de véhicules, en amont du rassemblement qu’ils avaient organisé, avant qu’un groupe d’agriculteurs et de résidents de Saint-Père hostiles à la mobilisation ne converge vers le lieu de rassemblement à la tête d’un convoi de tracteurs pour déloger les participants, sous le regard passif des gendarmes.
Lire aussi : Un paysan bio de 62 ans violemment arrêté suite à un pique-nique militant
Et si cette contre-mobilisation a finalement été contenue par les forces de l’ordre, qui sont intervenues avant que la situation ne s’envenime un peu plus, elle n’en est pas moins exemplaire de la bienveillance dont bénéficient les défenseurs du modèle agricole dominant de la part des pouvoirs publics, y compris lorsqu’ils semblent résolus à défendre leur vision du monde à coups de poings et de bâtons.
Ce n’est d’ailleurs là que l’aspect le plus visible du phénomène. Car au-delà de ces coups d’éclat, l’intimidation des militants écologistes, des journalistes critiques et des paysans bio se prolonge par des pratiques quotidiennes de harcèlement beaucoup moins médiatisées et judiciarisées.
Lire aussi : Pas de protection policière pour Morgan Large, journaliste gravement menacée pour ses enquêtes sur l’agro-industrie
Crédit photo couv : Des acteurs afghans jouent dans une pièce illustrant le lynchage en 2015 de l’afghane Farkhunda, à Kaboul le 17 mars 2016. Farkhunda est décédée le 19 mars 2015 après avoir été battue avec des bâtons et des pierres, jetée d’un toit, écrasée avec une voiture, brûlée, puis jetée dans une rivière, sous les yeux de la police, après avoir été faussement accusée d’avoir brûlé un Coran. – SHAH MARAI / AFP



 Retour
Retour