Dans un monde en crise – écologique, sociale, économique –, une émotion semble avoir disparu du paysage militant : la colère. Éric La Blanche, philosophe, essayiste et auteur publie "Osons la colère, éloge d’une émotion interdite par temps de crise planétaire". Il dénonce une société qui a diabolisé cette émotion pour mieux désarmer les citoyens, et appelle à une réappropriation urgente de la colère comme outil de transformation sociale.
La colère a toujours été le carburant des grandes révolutions et des conquêtes sociales. Alors, pourquoi la colère a-t-elle déserté les luttes contemporaines ? Pourquoi les militants écologistes l’oublient-ils au profit de l’anxiété ou la tristesse ? Et surtout, comment réhabiliter cette émotion pour en faire une force collective ?
La colère, un héritage de lutte
Pour Éric La Blanche, la colère n’est pas une émotion basique ou primitive, mais un moteur historique.
« Rien de grand et d’humaniste ne s’est fait dans le monde sans colère » affirme-t-il. Les révolutions, les conquêtes sociales, les soulèvements populaires ont presque toujours été portés par cette émotion.
« C’est une histoire de colère populaire, nationale, une histoire de groupes humains qui, à un moment, se sont dit : trop, c’est trop. »
Pourtant, aujourd’hui, la colère semble s’être absentée des radars militants. Pourquoi ? Parce qu’elle a été « volontairement interdite, réprimée », explique l’auteur. Depuis l’Antiquité, la colère a été progressivement dévalorisée, passant d’une émotion divine et valorisée (comme dans L’Iliade, où la colère d’Achille est au cœur du récit) à une émotion « basse », voire un péché mortel avec l’avènement du christianisme.
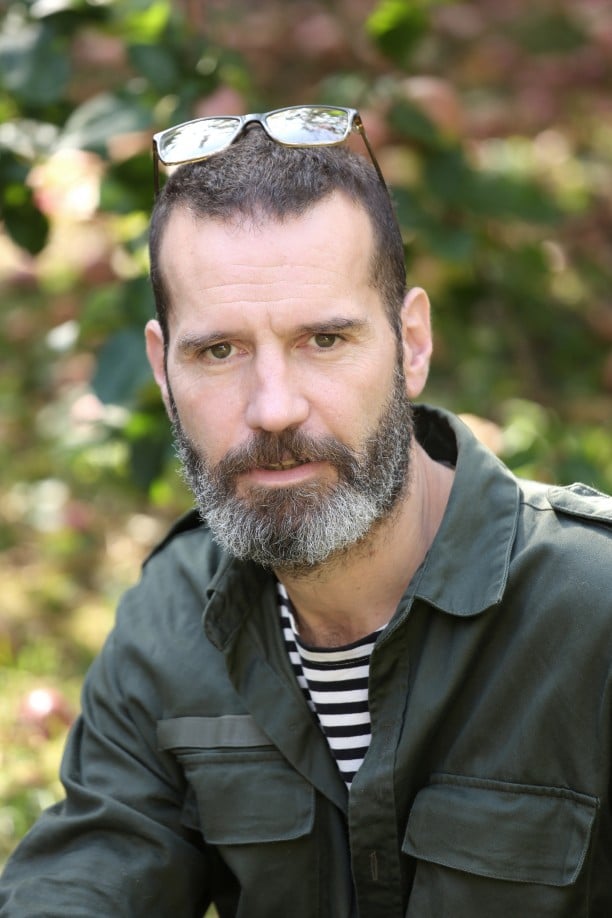
Éric La Blanche
La colère, victime du pouvoir
« Les dirigeants ont toujours eu peur de la colère populaire » souligne l’essayiste. En effet, la colère est une émotion qui pousse à l’action, à la révolte, à la revendication. Elle est donc dangereuse pour les pouvoirs en place, qui lui préfèrent la peur, la tristesse ou l’anxiété – des émotions qui paralysent plutôt qu’elles ne mobilisent.
Éric La Blanche cite l’exemple des mouvements écologistes actuels : malgré une masse scientifique accablante sur l’urgence climatique, les gens peinent à passer à l’action.
« On a tout pour réussir : les études, les dégâts… et pourtant, ça ne marche pas. » La raison ? L’absence de colère. « La colère est un déterminant fort de l’action, surtout quand il s’agit de rétablir la justice. » Mais la colère, c’est mal, c’est ce qu’on nous a appris.
L’un des principaux obstacles à la réhabilitation de la colère est son amalgame avec la violence.
« Dès qu’on parle de colère, on parle de violence » constate Éric La Blanche. Pourtant, la colère est une émotion, tandis que la violence est un comportement. « La colère est un signal d’alarme. Elle nous indique qu’on est en train de se faire marcher sur les pieds, de se faire spolier, de manquer de respect. »
L’auteur insiste sur la nécessité de dissocier les deux concepts. « La colère n’est ni bonne ni mauvaise. C’est un signal qui nous pousse à réagir. » En revanche, la violence – qu’elle soit physique, morale ou psychologique – est un excès de force, qui peut être légitime ou non selon le contexte.
Dans les milieux écologistes, la colère est souvent remplacée par l’anxiété. « L’anxiété, c’est une émotion mortifère, » dénonce le philosophe à La Relève et La Peste. « C’est une angoisse diffuse face à un avenir incertain. »
Or, la crise écologique n’est pas incertaine : elle est documentée, prévisible, et ses effets sont déjà visibles. « On devrait parler d’éco-trouille, d’éco-peur, pas d’éco-anxiété. »
L’anxiété, assure t-il, est une émotion favorisée par le système, car elle maintient les individus dans l’inaction. « Les gens anxieux restent dans leur canapé à regarder Netflix et à prendre des antidépresseurs. Le système peut continuer son business as usual. »
Retrouver le goût de l’action collective
Pour que la colère devienne une force collective, il faut l’organiser. Éric La Blanche s’inspire du concept de « banques de colère » développé par le philosophe Peter Sloterdijk.
« Une banque de colère, c’est un système où les individus déposent leur colère individuelle pour qu’elle n’explose pas en vain », explique Éric.
L’idée est de transformer les colères individuelles en un capital émotionnel collectif.
« Si je manifeste seul dans la rue avec un panneau Sauvez le climat, ça n’aura pas le même effet que si on est un million. » L’essayiste appelle donc à une agrégation des colères, via des mouvements collectifs : partis politiques, syndicats, ONG.
L’individualisme, né du capitalisme, est un frein majeur à l’action collective. Bien sûr, l’atomisation des sociétés humaines lui assure la plus grande tranquillité. Or, « l’individualisme n’a jamais fait progresser les luttes sociales, » rappelle l’auteur.
Les éco-gestes, bien que louables, ne suffiront pas à sauver la planète. De vraies décisions, c’est-à-dire à la hauteur de l’urgence écologique, impliqueraient d’arrêter les plus pollueurs, les plus destructeurs qu’Éric appelle les Brutes et les Dévoreurs. « Il faut agir collectivement et politiquement. »
Pour lui, les outils existent déjà : « Nous avons un char d’assaut dans le garage. Il s’appelle les partis, les syndicats, les ONG. » Il invite les citoyens à s’engager, ne serait-ce qu’en participant à des réunions ou en payant une cotisation. « La politique, ce n’est pas devenir homme ou femme politique. C’est appartenir à un mouvement. »
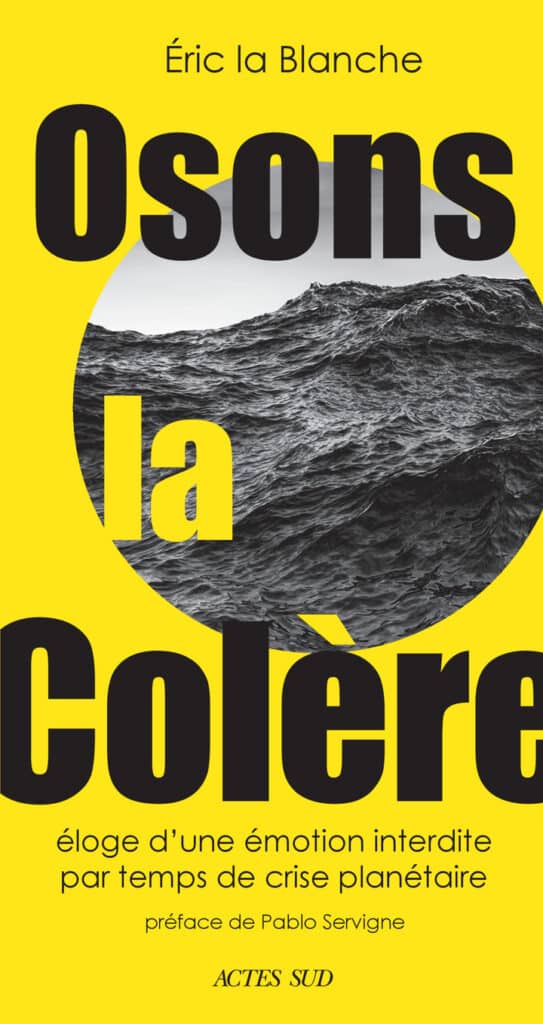
Nommer les coupables
Un autre point clé : nommer les responsables. « Il faut cesser de dire que c’est le système qui est criminel, » insiste Éric La Blanche. « Le système est dirigé par des gens. Ils ont des noms, ils agissent, ils sont responsables. » Que ce soit les patrons des multinationales ou les dirigeants politiques, il est temps de les désigner et de les tenir comptables de leurs décisions. On a fait passer devant les tribunaux les criminels de guerre. Éric attend de pied ferme les écocidaires devant la justice.
La Blanche critique la non-violence telle qu’elle est souvent revendiquée aujourd’hui : une non-violence « molle », « pour consommateurs paresseux ». « On nous vend une fausse non-violence pour nous désarmer. »
Il cite l’exemple de Gandhi ou de Martin Luther King, dont les luttes étaient inscrites dans un rapport de force. « La non-violence ne signifie pas l’absence de rapport de force. » Au contraire, pour être efficace, une lutte doit établir un rapport de force avec l’adversaire. Par ailleurs, il note la force de l’humour dans le combat contre l’argent comme contre les lobbyistes.
Redéfinir la violence
Éric La Blanche invite à repenser la notion de violence. « Est-ce que saboter un pipeline, c’est de la violence ? Est-ce que bloquer une usine en grève, c’est de la violence ? » Pour lui, la vraie violence est celle du système capitaliste, qui détruit la planète et les vies humaines.
« La société capitaliste est violente. Elle détruit tout avec le sourire. » Face à cette violence-là, la colère est non seulement légitime, mais nécessaire. Et non, ce n’est pas violent de faire grève, c’est même un droit constitutionnel !
Pour Éric La Blanche, la colère n’est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de se mettre en mouvement, de s’organiser, de lutter. « Il faut accepter de ressentir de la colère, et surtout, il faut savoir quoi en faire. »
Son livre, Osons la colère, est un appel à la réappropriation de cette émotion. « On ne changera pas le monde avec du Lexomil. Il faut de la colère, de l’indignation, et une organisation collective. »
En ces temps de crise planétaire, la colère n’est plus une option : c’est une nécessité. Comme le dit La Blanche, « si on veut établir un rapport de force, il faut de la colère. Sans elle, on a déjà perdu. »
S’informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.




 Retour
Retour